Je voudrais préciser ce que je cherche, avec cette série de billets. Disons-le de la manière la plus naïve : il me semble que le poème doit agir comme un filtre, ou un exhausteur de valeur, par lequel se révèle, du chaos de la vie, ce qui est digne d’en être aimé. Son opération est cosmique : il met en ordre le chaos et, sauvant les phénomènes de la contingence idiote où ils baignent, fait apparaître leur beauté.

J’ai découvert le manifeste de Frank O’Hara (que je possédais sans le savoir, à la fin des Selected Poems) dans les pages que lui consacre Stéphane Bouquet dans la Cité de Paroles : « Pour ce qui est du rythme et des autres questions techniques, traduit Bouquet, c’est juste le sens commun : si on achète un pantalon on veut qu’il soit assez moulant pour que tout le monde ait envie de coucher avec nous. » (Corti, 2018, cité p. 27) Au-delà de la provocation qui pourrait sembler un peu courte (le poème, loin d’être une grande chose à admirer, ne serait qu’un truc de séduction banal), l’image d’un point de vue pragmatique est parlante : comme un pantalon moulant, le poème ne crée pas, mais révèle l’objet du désir. Nous écrivons toute la journée dans des pantalons baggy aux rhétoriques trop lâches pour qu’elles renseignent quiconque sur l’architecture précise de notre rapport au monde. Le poème, pour sa part, ferait ça : tailler (par la langue) suffisamment près des zones sensibles, pour les faire apparaître dans leur incandescence.
Puisque le manifeste de O’Hara s’appelle Personism, il est autorisé de s’appuyer sur la pièce des Lunch Poems qui s’intitule « Personal Poem » (vous trouverez en ligne la version originale) dont voici la traduction d’Olivier Brossard et Ron Padgett (Poèmes déjeuner, Joca Seria, 2010, p. 34-35) :
Maintenant quand je me balade le midi
j’ai seulement deux porte-bonheur en poche
une vieille pièce romaine que Mike Kanemitsu m’a donnée
et un bouton tombé d’une caisse
quand j’étais à Madrid les autres ne m’ont jamais
vraiment porté chance même s’ils m’ont
permis de rester à New York envers et contre tout
mais maintenant je suis heureux pour un bout de temps et intéressé
Je marche à travers l’humidité lumineuse
en passant devant la House of Seagram avec ses flaques
et ses flâneurs et le chantier à
gauche qui a condamné le trottoir si
jamais je devins ouvrier dans le bâtiment
j’aimerais bien avoir un casque argenté s’il vous plaît
et j’arrive chez Moriarty où j’attends
LeRoi et entends qui veut être un battant
un gagnant depuis ans ma moyenne à la batte
est de .016 voilà, et LeRoi arrive
et me dit que Miles Davis a été frappé 12
fois hier soir devant BIRDLAND par un flic
une dame nous demande une petite pièce pour une maladie
effroyable mais on ne lui donne rien on
n’aime pas les maladies effroyables, et puis
on déjeune de poisson et de bière il fait
frais mais c’est bondé on n’aime pas Lionel Trilling
c’est tout vu, on aime Don Allen on n’aime pas
Henry James plus que ça on aime Herman Melville
on ne veut même pas faire partie de la procession des poètes à
San Francisco on veut juste être riches
et marcher sur des poutrelles avec nos casques argentés
je me demande si une personne sur 8 000 000 est en train
de penser à moi alors que je serre la main à LeRoi
et m’achète un bracelet à montre et retourne
au boulot heureux à l’idée que peut-être bien que oui
Comme leur titre l’indique, la plupart des Lunch Poems sont des pièces écrites « sur le pouce », pendant la pause de midi alors que Frank O’Hara travaillait au MoMA à New York. Matsumi « Mike » Kanemitsu, un peintre d’origine japonaise et LeRoi Jones, un écrivain afro-américain, sont deux amis de Frank O’Hara, qui rend donc compte ici de son trajet depuis son lieu de travail jusqu’à son déjeuner, en l’espèce « chez Moriarty ». Le poète longe un chantier et ses casques d’ouvriers, entend la voix d’un joueur de baseball, écoute son ami raconter la bavure dont a été victime Miles Davis la veille, et déjeune : poisson et bière. Après quoi, il prend congé et retourne au boulot.
Pourquoi faire d’événements aussi insignifiants tout un poème ?
Nous avons là une « improvisation », non pas strictement au sens musical (puisque le texte ne se performe pas au moment où il s’écrit), mais au sens où le poème se nourrit des éléments que lui fournit par hasard son environnement, pour tisser à partir d’eux une forme de nécessité, certes lâche, mais qui suffit à leur conférer une sorte de sens. Le plus caractéristique, à ce titre, me semble être le « casque argenté » : on le croise vers 13-14 comme l’objet d’un décor d’autant plus contingent que des travaux, par définition, sont des interventions ponctuelles sur la voie publique (qu’on n’aurait pas rencontrées un autre jour et vouées à disparaître) ; on le retrouve, 5 vers avant la fin, comme rien de moins que la définition d’un projet existentiel : « on veut juste […] marcher sur des poutrelles avec nos casques argentés ». La poésie se fait ainsi herméneutique (joyeuse, enthousiaste, décomplexée, non dénuée d’ironie) de la vie dans sa profusion bigarrée, jusqu’à tirer des accidents les plus triviaux mêmes la définition du souverain bien.
L’improvisation est le nom de ce travail, il touche à la question du salut : car non seulement la scène du réel est sauvée de son insignifiance fondamentale (puisqu’elle a offert une figure du bonheur), mais par le miracle de la lecture, il y a bien « une personne sur 8 000 000 [qui] est en train / de penser à moi » : le lecteur. Du rien qu’est une pause-déjeuner, identique à toutes les autres et vouée à être oubliée, naît subjectivement dans le poème un irréductible du sens, et par son partage, sa lecture, une rencontre avec autrui qui m’ouvre le royaume de l’intersubjectivité.
Voilà un billet trop court, beaucoup trop peu étayé. C’est pourtant là que je voulais en venir : le poème, improvisation adressée, doue la vie de valeur parce qu’il trouve le souverain bien dans la contingence pure et sauve, dans le même mouvement, le réel et son poète. Cela requiert, je crois, un certain travail de la forme sur lequel je me pencherai une prochaine fois.
.
.
.
 Un peu plus haut dans le même article, Para cite Demangeot : « La poésie doit saboter le réel et le rendre vivant » : qu’est le négatif, dans cette histoire ? Le réel lui-même, à saboter ? Ou la poésie, qui le sabote ? Et en quoi consiste cette « vie » qu’il faut lui faire avouer, cracher ? Il est bien difficile de paraphraser les poèmes de Demangeot, tant la signification y est constamment en lutte contre elle-même. Et comme il est plus encore impossible de résumer toute une œuvre caractérisée, de Désert natal à Promenade et guerre (auquel j’avais consacré
Un peu plus haut dans le même article, Para cite Demangeot : « La poésie doit saboter le réel et le rendre vivant » : qu’est le négatif, dans cette histoire ? Le réel lui-même, à saboter ? Ou la poésie, qui le sabote ? Et en quoi consiste cette « vie » qu’il faut lui faire avouer, cracher ? Il est bien difficile de paraphraser les poèmes de Demangeot, tant la signification y est constamment en lutte contre elle-même. Et comme il est plus encore impossible de résumer toute une œuvre caractérisée, de Désert natal à Promenade et guerre (auquel j’avais consacré 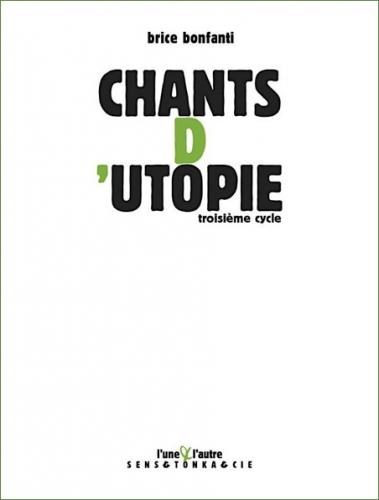
 1. La chanson qui jouit
1. La chanson qui jouit